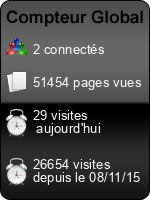Méditer c’est s’arrêter. S’arrêter de faire, de remuer, de s’agiter. Se mettre un peu en retrait, se tenir à l’écart du monde.
Au début, ce qu’on éprouve semble bizarre :
il y a du vide (d’action, de distraction) et du plein (tumulte des pensées et des sensations dont on prend soudainement conscience).
Il y a ce qui nous manque, nos repères et des choses à faire ; et, au bout d’un moment, il y a l’apaisement qui provient de ce manque.
Les choses ne se passent pas comme à «l’extérieur», où notre esprit est toujours accroché à quelque objet ou projet : agir, réfléchir sur un sujet précis, avoir son attention captée par une distraction.
Dans cette apparente non-action de l’expérience méditative, on met du temps à s’habituer, à voir un peu plus clair. Comme dans le tableau. Comme lorsqu’on passe de la lumière à l’ombre.
Nous sommes entrés en nous-mêmes, pour de vrai. C’était tout près de nous, mais nous n’y allions jamais. Nous traînions plutôt dehors : à notre époque de sollicitations effrénées et de connexions forcenées, notre lien à nous-mêmes reste souvent en friche. Intériorités abandonnées… les extériorités sont plus faciles, et plus balisées. Alors que l’expérience méditative est souvent une terre sans sentiers.
Dans la pièce où médite le philosophe, il y a moins de lumière, alors il faut ouvrir les yeux plus grand.
En nous-mêmes aussi : il y a moins d’évidences et de réassurances, alors nous avons à ouvrir plus grand les yeux de notre esprit.
On pensait, on espérait trouver le calme, le vide. On tombe souvent sur un grand bazar, du tapage, du chaos. On aspirait à la clarté, on a trouvé la confusion.
Parfois, méditer nous expose à l’angoisse, à la souffrance, à ce qui nous fait souffrir et qu’on évitait en pensant à autre chose, en s’agitant ailleurs.
Revue de presse
Onze minutes de méditation guidée par Christophe André
pour mieux se détacher de ses pensées.